« Le destin n’a pas épargné l’écrivain que fut Elizabeth Browning. Nul ne la lit, nul n’en parle, nul ne songe à lui rendre justice. »
(Virginia Woolf, article du Common Reader, 1931)
Je ne parle pas ici assez de poésie à mon goût, peut-être parce que ce n’est pas un genre actuellement très valorisé et pourtant, j’ai un grand amour pour la poésie. J’ai même publié « Éclaircie de passage », l’un de mes poèmes sur ce blog l’an dernier, c’est quelque chose que je pratique très régulièrement mais je comprends la réticence de certains pour la poésie même si pour moi, ça a toujours été très naturel de lire et d’écrire des poèmes.

John Keats (Ben Whishaw) dans Bright Star
Tout naturellement, en tant qu’anglophile, je ne pourrais pas me passer des poètes anglais pour vivre. Shakespeare, John Keats, William Blake, Lord Byron, Wordsworth, Coleridge, les sœurs Brontë ou Oscar Wilde sont d’éternelles sources d’inspirations et de plaisir pour moi. Vous l’aurez peut-être noté, rien que dans ma liste, les poétesses n’ont pas une grande place dans toute anthologie qui se respecte ce qui confirme ce qui disait Virginia Woolf dans Une chambre à soi sur la difficulté que représente l’accession au statut de poète pour une femme sans un minimum de conditions matérielles favorables.
J’ai une tendresse toute particulière pour Emily Brontë et Emily Dickinson (dire qu’il faille traverser l’Atlantique pour trouver une poétesse digne de ce nom) qui, en plus de leur prénom, partage une même aura mystérieuse autour de leur vie et de leur oeuvre. Si vous l’avez l’occasion de vous procurer La dame blanche de Christian Bobin, vous aurez en main ce qui m’a donné envie de découvrir Emily Dickinson grâce à cette très belle biographie plus ou moins romancée.
Toutefois, c’est d’une poétesse beaucoup moins connue que j’ai envie de vous présenter, qui a eu une vie (à mon sens) très romanesque et que j’ai découverte grâce à Virginia Woolf : Elizabeth Barrett Browning. Virginia Woolf a le chic de sortir de l’anonymat des auteurs inconnues (la soeur de Shakespeare, Christina Rossetti ou Sara Coleridge pour ne citer qu’elles) et de nous donner envie de les lire sur le champ ! Ça a été mon cas avec Elizabeth Barrett Browning, femme du poète Robert Browning et dont les vers de ses Sonnets portugais ont donné furieusement envie à Rainer Maria Rilke de les traduire en allemand. Vous avez peut-être entendu parler de Flush de Virginia Woolf (l’une de mes prochaines lectures pour le challenge Virginia Woolf) et c’est par ce biais que j’ai été séduite par Elizabeth Browning sans même lire une seule ligne de cette biographie du point de vue du chien de la poétesse ce qui déjà aiguiserait la curiosité de n’importe quel lecteur.
Passage obligé quand on lit de la poésie anglaise, j’ai découvert les Sonnets portugais dans son édition bilingue de la NRF (la même que j’ai pour les poèmes d’Emily Brontë bien que j’ai fait l’acquisition récemment d’une version audio des poèmes de la famille Brontë, un régal, mes amis !) et, comme d’habitude, la traduction est pourrie (pardon pour la traductrice, Lauraine Jungelson) mais permet de sauver les meubles quand le sens d’une strophe nous échappe vraiment. Par contre, l’appareil critique est comme toujours très instructif surtout pour une poétesse aussi peu populaire. La préface est remplie d’anecdotes, d’extraits de correspondances (quand on sait qu’Elizabeth et Robert ont échangé 574 lettres, rien que ça !) en retraçant l’histoire du couple et la postérité des Sonnets portugais.
D’ailleurs, qu’est-ce qui est à l’origine des Sonnets portugais ? Il faut avant tout comprendre qui était Elizabeth Barrett avant et après avoir écrit ces sonnets. Avant ça, atteinte d’une étrange maladie incurable , mélancolique depuis la mort de son frère préféré, recluse dans la maison familiale à Wimpole Street et destinée apparemment à rester vieille fille toute sa vie sous la pression d’un père autoritaire, elle va tout de même publier un recueil de poèmes qui la rend célèbre en Angleterre et outre-atlantique et ce recueil va arriver dans les mains de Richard Browning. Il va lui écrire ces mots :
« J’aime vos vers de tout mon coeur, chère Miss Barrett […]. Dans cet acte de m’adresser à vous, à vous-même, mon sentiment s’élève pleinement. Oui, c’est un fait que j’aime vos vers de tout mon coeur, et aussi, que je vous aime vous. »
Je n’ose imaginer ça en anglais ! Au début, comme toutes les rock-stars qui reçoivent des lettres d’amour, elle va gentillement le refouler et ne lui offrir que son amitié. Ils vont mettre du temps à se rencontrer en personne (à cause des réticences d’Elizabeth visiblement qu’il soit déçu de cette rencontre à cause de sa maladie). Après une première demande par écrit qu’elle refusera tout en reconnaissant que cet homme l’obsède sans y voir encore de l’amour, après de nouvelles rencontres en l’absence de son père (qui, forcément, ne voit pas l’arrivée Robert d’un bon œil dans la vie monacale de sa fille), accepte finalement sa proposition à la seule condition que sa santé s’améliore, ce qui retarde encore un peu plus leur union. Finalement, le mariage est précipité en septembre 1846 dans le plus grand secret et sans le consentement du père. Comme dans tous les romans qui se respectent après un tel événement, ils décident de s’enfuir en Italie, à Florence.
 C’est de cette rencontre décisive, autant amoureuse que humaine qu’Elizabeth Barret va écrire ses Sonnets portugais jusqu’à son mariage, à l’insu de Robert Browning et forcément de sa famille. Ces Sonnets from the Portuguese décrivent l’évolution de ses sentiments, comme un relevé presque journalier ce qui en fait une magnifique étude sur l’amour et la place de plus en plus envahissante de la passion dans la vie d’une femme amoureuse qui, enfin, vit pleinement les choses. Je ne crois pas que le titre de ce recueil soit une référence aux célèbres Lettres portugaises de Guilleragues, présentées faussement comme la traduction de lettres d’une religieuse portugaise à un officier français, longtemps attribuée à une vraie religieuse. La coïncidence est tout de même assez troublante car Elizabeth Barrett, vivant comme une femme recluse, dialogue dans ses Sonnets avec l’être aimé où elle suit le même parcours évolutif de doute, de confiance et d’amour sauf qu’il était rapportée dans les Lettres portugaises à la foi et non à l’amour charnel.
C’est de cette rencontre décisive, autant amoureuse que humaine qu’Elizabeth Barret va écrire ses Sonnets portugais jusqu’à son mariage, à l’insu de Robert Browning et forcément de sa famille. Ces Sonnets from the Portuguese décrivent l’évolution de ses sentiments, comme un relevé presque journalier ce qui en fait une magnifique étude sur l’amour et la place de plus en plus envahissante de la passion dans la vie d’une femme amoureuse qui, enfin, vit pleinement les choses. Je ne crois pas que le titre de ce recueil soit une référence aux célèbres Lettres portugaises de Guilleragues, présentées faussement comme la traduction de lettres d’une religieuse portugaise à un officier français, longtemps attribuée à une vraie religieuse. La coïncidence est tout de même assez troublante car Elizabeth Barrett, vivant comme une femme recluse, dialogue dans ses Sonnets avec l’être aimé où elle suit le même parcours évolutif de doute, de confiance et d’amour sauf qu’il était rapportée dans les Lettres portugaises à la foi et non à l’amour charnel.
 Selon moi, un recueil de poésie se lit différemment par rapport à toute oeuvre littéraire. J’aime délibérément sauter des poèmes, lire certains plusieurs fois quand ils me touchent plus que les autres ce qui représente une lecture presque aléatoire. J’aime bien aussi piocher dans un recueil un poème au hasard, ce qui veut dire que je prends chaque poème pour lui-même et pas forcément dans sa relation avec tout le recueil. Parfois, c’est une lecture qui fonctionne, parfois non mais c’est sûr que ce n’est pas très académique et scolaire. De même, si on voit ces poèmes comme un parcours linéaire vers l’amour, ce n’est peut-être pas la lecture la plus judicieuse mais je n’en ai pas moins aimé les vers d’Elizabeth Browning et la sincérité de ses sentiments sans avoir besoin de retracer un parcours figé. Quand j’ai dû lire Les Regrets de Du Bellay en prépa pour le concours, je n’ai pas pu faire ça par exemple ce qui distingue surement une lecture imposée et une lecture pour le plaisir, pour l’amour de la poésie.
Selon moi, un recueil de poésie se lit différemment par rapport à toute oeuvre littéraire. J’aime délibérément sauter des poèmes, lire certains plusieurs fois quand ils me touchent plus que les autres ce qui représente une lecture presque aléatoire. J’aime bien aussi piocher dans un recueil un poème au hasard, ce qui veut dire que je prends chaque poème pour lui-même et pas forcément dans sa relation avec tout le recueil. Parfois, c’est une lecture qui fonctionne, parfois non mais c’est sûr que ce n’est pas très académique et scolaire. De même, si on voit ces poèmes comme un parcours linéaire vers l’amour, ce n’est peut-être pas la lecture la plus judicieuse mais je n’en ai pas moins aimé les vers d’Elizabeth Browning et la sincérité de ses sentiments sans avoir besoin de retracer un parcours figé. Quand j’ai dû lire Les Regrets de Du Bellay en prépa pour le concours, je n’ai pas pu faire ça par exemple ce qui distingue surement une lecture imposée et une lecture pour le plaisir, pour l’amour de la poésie.
En voici, quelques uns :
XLIII – How do I love thee? Let me count the ways.
How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal Grace.
I love thee to the level of every day’s
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
I shall but love thee better after death.
VII – The face of all the world is changed, I think,
The face of all the world is changed, I think,
Since first I heard the footsteps of thy soul
Move still, oh, still, beside me, as they stole
Betwixt me and the dreadful outer brink
Of obvious death, where I, who thought to sink,
Was caught up into love, and taught the whole
Of life in a new rhythm. The cup of dole
God gave for baptism, I am fain to drink,
And praise its sweetness, Sweet, with thee anear.
The names of country, heaven, are changed away
For where thou art or shalt be, there or here;
And this… this lute and song… loved yesterday,
(The singing angels know) are only dear
Because thy name moves right in what they say.
Et, comme les Sonnets portugais sont suivis d’autres poèmes, voici mon préféré dans tout le recueil, intitulé « Inclusions ». Il a quelque chose à voir avec le mythe de l’androgyne dans le Banquet de Platon, maintenant populairement appelés « les âmes sœurs ». derrière, cette figure, l’amour est l’inclusion parfaite, l’emboîtement et l’harmonie entre deux personnes qui s’oublient elles-mêmes pour ne faire qu’un.
INCLUSIONS
1
O, WILT thou have my hand, Dear, to lie along in thine?
As a little stone in a running stream, it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, Dear,… unfit to plight with thine.
2
O, wilt thou have my cheek, Dear, drawn closer to thine own?
My cheek is white, my cheek is worn, by many a tear run down.
Now leave a little space, Dear,… lest it should wet thine own.
3
O, must thou have my soul, Dear, commingled with thy soul? —
Red grows the cheek, and warm the hand,… the part is in the whole!
Nor hands nor cheeks keep separate, when soul is join’d to soul.
Où se procurer les Sonnets portugais ?
Sonnets portugais d’Elizabeth Barrett Browning
Poésie Gallimard – 178 pages
C’est ma 10e et dernière contribution au mois anglais organisé par Lou et Titine. Retrouvez mon bilan ci-dessous.
Bilan du Mois anglais 2013
10 contributions : 2 romans, 1 essai, 1 pièce de théâtre, 1 recueil de nouvelles, 1 recueil de poésie, 1 billet thématique et 3 séries TV.
– La Traversée des apparences de Virginia Woolf
– Snobs de Julian Fellowes
– Une chambre à soi de Virginia Woolf
– Look Back in Anger de John Osborne (extrait)
– Les Intrus de la Maison Haute de Thomas Hardy
– Sonnets portugais d’Elizabeth Barrett Browning
– Home Sweet Home : Quatre maisons d’écrivains anglais
– Ripper Street (BBC, 2012)
– Little Dorrit (BBC, 2008) d’après Charles Dickens
– Any Human Heart (2010) d’après William Boyd
Merci aux organisatrices et aux autres participant(e)s qui l’ont rendu aussi vivant et particulièrement en lisant et commentant mes dix billets. J’ai eu autant de plaisir à vous lire et à être tentée par autant d’idées de lecture. Vive l’anglophilie, le mois anglais et à l’an prochain pour son come back !
Comme les autres participant(e)s, j’ai répondu à l’invitation d’un jeu photo en mettant en scène mon coup de coeur du mois anglais (« Une chambre à soi » de Virginia Woolf, forcément) avec une tasse, ici celle à l’effigie de la maison Serpentard !












 C’est avec la très belle et sensuelle Tess (Holliday Grainger) que les ennuis commencent. Je ne vous en dis pas plus mais la perte de la virginité de Logan va avoir quelques conséquences, comme le début de son goût pour le mensonge. Petit clin d’œil, Holliday Grainger est apparue dans la saison 3 de
C’est avec la très belle et sensuelle Tess (Holliday Grainger) que les ennuis commencent. Je ne vous en dis pas plus mais la perte de la virginité de Logan va avoir quelques conséquences, comme le début de son goût pour le mensonge. Petit clin d’œil, Holliday Grainger est apparue dans la saison 3 de 












































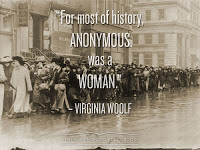










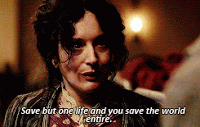








































Commentaires récents